Mon troisième roman, la suite des aventures de Victor, vient de paraître !
Victor Brennan, le héros de
"DES COLTS ET DU BEETHOVEN"
revient !
PARTIE I
EN ATTENDANT MIEUX
I
Le train avait quitté Omaha depuis peu et
filait droit sur Chicago. En cette matinée d’octobre 1877 le ciel était si bas
que la cheminée de la locomotive à vapeur semblait devoir le fendre pour s’y
ouvrir un passage. La fumée qui s’échappait d’elle se mêlait aux noires nuées. Un
fantastique orage se préparait. La machine fonctionnait à plein régime. Elle
donnait l’impression de vouloir s’éloigner au plus vite de la capitale du
Nebraska, ne désirant pas s’attarder dans ces immenses plaines solitaires dont
seule une maigre bourgade ou une exploitation isolée venaient rompre la
monotonie.
Cela faisait déjà quatre jours que Victor[1] voyageait. Dans la matinée
du premier octobre, il était monté dans le train du Pacific Railroad qui avait
parcouru sans incident notable les mille cinq cents miles séparant San
Francisco d’Omaha, passant par Salt Lake City et Denver. Ah Denver… Victor
aurait bien voulu s’y attarder pour aller saluer ses amis, notamment Lily et
Martin, ou déambuler dans les rues de cette belle ville qu’il aimait tant. Mais
il n’en était pas question. Pas question non plus de descendre à Omaha, sa
ville natale. Il n’avait pu y faire qu’une courte halte. A peine avait-il eu le
temps d’avaler un café et un œuf au plat dans un saloon près de la gare qu’il
avait dû sauter dans le train en partance pour Chicago. Radomir avait été
catégorique sur ce point : il lui était formellement interdit de s’arrêter
en cours de route. Il était attendu de pied ferme à Washington pour le mardi
huit octobre. En cas de retard d’un train, dû à un accident ou à toute autre
raison, Victor devait impérativement et sans délai le signaler par télégramme à
Radomir. Et encore ! Cela serait ensuite vérifié à Washington. Pas de
tromperie possible. Sous peine d’être remis en prison aussitôt.
Toutefois, Radomir avait bien fait les
choses. Pour adoucir les rigueurs de ce très long voyage - la traversée des
Etats-Unis d’Ouest en Est, soit plus de deux mille huit cent miles - il lui
avait réservé, pour chaque nuit passée à bord, une place de voiture-lit. Victor
pouvait ainsi, le soir tombé, se retirer derrière les lourds rideaux de satin
amarante et disposer d’une confortable couche. Néanmoins, malgré le calme qui
régnait dans le wagon, Victor ne parvenait pas à dormir paisiblement. Car, si
en cette journée d’automne l’orage allait éclater sous peu, cela faisait quatre
jours que la tempête grondait sous son crâne. Depuis son départ précipité de
San Francisco, il n’avait cessé de tourner et retourner le problème dans tous
les sens. Sans en trouver la moindre issue…
Le Service Secret. Agent du Service Secret
des Etats-Unis. Ça consiste en quoi en fait ? Parce que Domir, il ne m’a
pas vraiment expliqué la chose en détail. Aussi, nos retrouvailles ont été si
courtes. A peine quelques heures. Que m’a-t-il dit ? Ah oui, que c’était assez
nouveau, il a été créé il y a douze ans. Et puis ? Qu’il luttait contre la
fausse monnaie, la contrebande et les fraudes foncières. Oh, comme ce doit être
passionnant ! Pff, agent du Service Secret ! Je n’ai vraiment pas envie
d’entrer là-dedans, moi ! Déjà que je suis parti de chez Pinkerton car je
ne supportais pas leurs ordres ineptes. Alors là, m’occuper de fausse
monnaie ! Aller courir au Mexique, comme Domir, ou dans quelque autre coin
oublié de Dieu, risquer sa vie, pour pourchasser quelques malheureux
faux-monnayeurs ! De la fausse-monnaie ! Qui s’en soucie ? Pff,
quelques dollars de plus ou de moins, quelle importance ? Et tout ça pour
quel salaire ? Domir ne me l’a pas dit. Ah, mais qu’est-il allé faire dans
cette galère ? Quelle idée lui est passée par la tête d’aller se fourrer
dans ce Service Secret ? Et de m’y embringuer par la même occasion !
Mmm, il m’a dit qu’il n’avait pu faire autrement. Soit il acceptait, soit
c’était la corde. Aussi… il faut dire… Il n’a pas toujours été très
raisonnable... Il avait tendance à sortir son arme pour un oui ou pour un non.
Un formidable coup de tonnerre retentit.
Certains passagers en sursautèrent. Victor tourna machinalement la tête vers la
fenêtre. Une forte pluie battait la vitre et des éclairs striaient le ciel
désormais noir comme de la suie. Mais il ne prêta guère attention à ces
déchaînements de la nature, tant il était absorbé dans ses pensées. Il était à
ce point préoccupé qu’il n’avait même pas remarqué que depuis Omaha une
mignonne brunette tentait d’attirer son regard, apparemment séduite par ce beau
jeune homme, si élégant et courtois - Victor avait aidé la maman de la jeune
fille à mettre son panier dans le filet au-dessus de leur tête. L’obscurité
avait envahie la voiture, un agent arrivait pour allumer les lampes disposées
au plafond. La brunette prit alors une jolie boite en fer-blanc dans le sac qui
était à ses pieds et l’ouvrit délicatement. Elle contenait des biscuits d’un
beau rose qui dégageait une odeur bien appétissante. La jeune fille hésitait à
en offrir un à son charmant voisin, intimidée par son air sombre et soucieux.
Mais… C’est que moi non plus, je ne peux
pas refuser d’entrer dans ce fichu Service Secret. Ah quelle guigne !
Radomir me l’a bien redit avant que je ne le quitte, ce James… James comment
déjà ? West ? Non, c’est ridicule ça, James West, ce n’est pas ça.
James… Oh, je ne sais plus. J’aurai bien le temps de vérifier cela, j’en ai
encore pour trois jours avant d’atteindre Washington. Enfin, ce James est un
chef influent du Service Secret et il n’est pas du genre à plaisanter. Il ne
manquera pas de me faire rechercher à travers tout le pays pour me faire
arrêter si je ne me présente pas à lui. Et qui dit arrêté… dit pendu ! Ah,
vraiment, quelle guigne. Ce Domir… Il n’aurait pas pu agir autrement ? Il
ne pouvait pas juste me tirer de prison, faire en sorte que je sois innocenté
et on en restait là ! Il m’a assuré que cela ne lui avait pas été
possible, qu’il n’avait pu obtenir ma libération qu’après avoir réussi à
persuader - difficilement - ce fameux James que je ferai une excellente recrue
pour le Service Secret. Mmm, est-ce que c’est bien sûr, ça ? Il n’a
peut-être pas tout tenté ?
Oh !! Heureusement Radomir
n’entendait pas les pensées de son cher ami ! « Pas tout
tenté » ! Radomir ? Lui qui, pendant plusieurs jours avait vécu
dans l’angoisse de le voir mourir et qui avait œuvré d’arrache-pied pour le
sauver !
Non sans une inconséquence certaine,
Victor estimait qu’il était désormais en droit de poursuivre sa vie à sa guise
malgré les crimes qu’il avait commis. Comme il l’avait toujours fait. Après
tout, quand il était tueur à gages, nul ne l’avait jamais empêché de mener
l’existence qu’il souhaitait. Sauf lorsque Blake Hole lui avait envoyé ces
trois mercenaires à ses trousses et qu’il avait bien failli y passer. Mais tout
cela était terminé. Blake Hole reposait maintenant dans un cimetière de Boston,
Victor l’ayant abattu un an plus tôt.
Bon, bien sûr, Radomir, j’ai une entière
confiance en lui. Je ne remets pas sa parole en doute. Jamais je ne me
montrerai ingrat envers lui. Après la mort de papa, il a été tout pour moi. Je
l’aime comme un frère, comme un père, Radomir. Je lui dois tellement. Je ne
savais rien de la vie avant lui, il m’a initié à tellement de choses. C’est lui
qui m’a appris à manier un Colt…
Machinalement, Victor
glissa sa main gauche sous son manteau, pour vérifier que les deux armes
données par son vieil ami étaient toujours
bien à leur place. Ils s’agissaient des deux mêmes Colts que Radomir lui
avait offerts le jour de ses vingt-et-un ans. Ce grand diable de Tchèque avait
réussi à les récupérer auprès du shérif de San Francisco.
Et sans lui, que serais-je devenu, quand
je suis parti comme un jeune fou à la recherche des meurtriers de mon
père ? Je n’avais même pas dix-sept ans. C’est lui qui a guidé mes
premiers pas dans l’Ouest. Et surtout, je lui serai éternellement reconnaissant
de m’avoir sorti de cette effroyable situation. Car malgré ses belles paroles,
je ne pense pas que l’avocat aurait pu m’éviter la peine de mort. Ah, tout cela
à cause de ce crétin d’Albert ! Qu’est-il venu sur scène se faire trouer
la peau ! En tout cas, à l’heure qu’il est, sans l’intervention salvatrice
de Domir, mon corps, dépendu, reposerait six pieds sous terre. Et maman, Laura
et Elmer pleureraient de concert sur ma tombe dans un cimetière de San
Francisco. Oui, toute ma vie, j’éprouverai de la gratitude et de l’amour pour
Domir… Et de l’admiration ! Quel violoniste ! Combien j’aimerais
encore jouer avec lui notre sonate, « Le printemps », de
Beethoven !
Victor se tourna un peu sur son siège et
vit enfin la jeune fille brune qui s’enhardit alors à lui tendre un de ses
gâteaux. Il la remercia et le prit bien volontiers car l’œuf avalé en vitesse à
Omaha n’avait guère calmé sa faim.
-
Je les ai faits moi-même, précisa la jeune
femme d’une voix fluette.
Victor, la bouche pleine, se contenta de
hocher la tête et de la gratifier d’une espèce de sourire qui ressemblait
plutôt à une grimace. C’est que le gâteau, malgré son doux parfum, était dur
comme du bois. Il ne parvenait pas à le croquer et se demandait s’il n’allait
pas se casser une dent dessus. Quand elle lui proposa d’en prendre un autre, il
lui lança un regard reconnaissant et lui fit un petit signe de la main - étant
toujours dans l’incapacité de parler - pour lui signifier qu’un seul suffirait.
Puis, désirant couper court à ce qui pouvait être un début de conversation, il
fit mine de se plonger dans le journal qu’il avait acheté à Omaha, afin de
pouvoir s’adonner pleinement à ses réflexions.
Il faut que je trouve autre chose pour
m’en sortir… Et si je quittais les Etats-Unis ? Pour le Mexique ?
Bah, le Mexique… ça ne me dit rien à moi ! Allais me perdre dans leurs
fichus déserts, m’ennuyer dans leurs villages miteux ! Y a-t-il seulement
des villes au Mexique ? D’ailleurs comment s’appelle leur capitale ?
S’ils en ont une ! Ou
alors… partir en Europe ? En Angleterre ? Ou en France. Après tout,
je parle le français - même si maman me dit que je fais parfois des fautes. Je
peux trouver un travail. Mmm… Donner des leçons de piano ? Ou m’exhiber en
concert ? Ce n’est pas une perspective folichonne. Enfin, ça, comment
gagner ma vie, je verrai plus tard. Je vais bientôt arriver sur la côte Est, là
je ne suis pas recherché - enfin, pas pour l’instant - donc je suis libre de
monter dans un navire pour la France. Je ne sais pas si les quelques dollars
qui me restent suffiront à payer mon passage, mais tant pis, je proposerai de
travailler à bord. Oui mais, quitter les Etats-Unis… Et Laura ? Et
maman ? Oh, Laura, si elle m’aime autant qu’elle le dit, elle me suivra
bien dans n’importe quel pays. Elle pourra être médecin en France. Elle aura
juste à apprendre la langue. Et maman ? Cela lui fera peut-être plaisir de
revenir dans son pays natal ? Pour ce qui est de ce gros fainéant de
George Walter - quelle idée a-t-elle eu de l’épouser, cet homme sans
caractère ? - elle en fait ce qu’elle veut, il la suivra jusqu’au bout du
monde. Même s’il fera la tête. Il ne souhaite rien tant que de revenir à Omaha.
Revenir à Omaha. Victor aussi aurait aimé
retourner dans sa ville natale. Il repensa à son enfance. A son père. Quand il
lui permettait de le retrouver à la banque en fin de journée. Lorsqu’il lui
avait offert son premier cheval. Il sourit en repensant à la frayeur de sa
mère. « Il est trop petit, il va tomber ! », ne cessait-elle de
s’écrier. Le rêve de son père, élever des chevaux, brisé par sa mort
prématurée… Et cette petite fille au si fort caractère, qui lui
disait : « Plus tard tu seras juge comme papa et nous nous
marierons »… Laura. Jamais il n’aurait pu imaginer à cette époque qu’elle
deviendrait sienne. Il se revit arpentant les rues poussiéreuses de la ville.
Entrer dans la belle maison de sa mère, qu’il retrouvait toujours avec plaisir
après ses dangereuses expéditions. Même s’il leur arrivait de se disputer un
peu. Et le vieux Tom ! Qui s’occupait si bien de ses montures. Puis vint
le souvenir des folles journées passées avec Octavie à Denver. Les
merveilleuses chevauchées à travers les grandes plaines sur son infatigable
Terpsichore. Terpsichore ! S’il partait, il ne reverrait plus jamais sa
magnifique jument tant aimée ! Il secoua la tête - la brunette, qui ne le
quittait pas des yeux, pensa qu’il désapprouvait le contenu d’un article. Non,
décidément, il n’avait pas envie de quitter son pays. De partir pour un
ailleurs inconnu. Loin de ses amis. Loin des siens.
Et puis Laura qui me suivra où que
j’aille… C’est vite dit ! C’est que Laura, elle n’a pas un caractère
facile. Il n’est pas sûr du tout qu’elle accepte de partir de San Francisco.
C’est une vraie tête de mule par moments. Quant à maman… Elle ne viendra pas
non plus en France. Elle me l’avait dit, après la mort de papa, que pour elle,
la France, c’était fini. Elle ne voulait plus jamais y remettre les pieds. C’était
une vie trop triste. La mort de sa mère. Une histoire d’amour avec son cousin
qui s’était mal terminée. La pingrerie de son père. Elle m’a raconté qu’elle
avait tout le temps froid car il refusait de mettre le chauffage avant la Toussaint… Et puis, j’ai bien l’impression qu’elle ne
veut plus retourner à Omaha. Juste avant cette sale affaire à cause de ce
crétin d’Albert, elle s’était mise en tête d’acheter une maison non loin de
celle de la sœur d’Elmer, dans ce beau quartier de Russian Hill. Et aussi
d’ouvrir une nouvelle boutique de chapeaux sur Market Street.
Il leva les yeux de son
journal. Cependant comme il vit la brunette aussitôt lui sourire, avec sa boite
en fer-blanc à la main, il se replongea dans son journal. En d’autres temps, il
se serait comporté bien différemment, mais dans le cas présent, il n’avait pas
le cœur à jouer les séducteurs. Et puis il y avait Laura. Il en était tellement
épris qu’il était sûr de lui être éternellement fidèle.
L’orage se calmait. Le soir approchait.
Les voyageurs les plus aisés n’allaient pas tarder à regagner leur couchette.
Quand même ce Domir… Dans quel pétrin il
ne m’a pas fichu, avec son satané Service Secret ! A cause de lui, me
voilà obligé de traverser les Etats-Unis d’Ouest en Est ! Et qui plus est,
à un train d’enfer. Tout ça pour me mettre sous la coupe de ce type, là, de ce
James… James quelque chose, pour pourchasser trois ou quatre malheureux qui
impriment de faux billets ! C’est bon que j’étais tellement surpris quand
j’ai revu Radomir ! Mais j’aurais dû lui dire, que je ne voulais pas de
son Service Secret. Et puis, pendant combien d’années je vais devoir y
rester ? Il ne m’a pas dit ! Parce que, moi, je veux retrouver ma
liberté un jour. Pff, quelle guigne ! En même temps, si je n’y vais pas,
je trahis Domir. Et ça, trahir Domir, ça ne m’est pas possible. Même si… Il
faut bien dire que… il n’était pas là, quand j’avais tous ces tueurs aux
trousses, l’année dernière. Ce n’est pas sa faute, ouais, je sais, mais, bon…
C’est juste pour dire… Bref, je vais faire ce qu’il me demande, mais, ça me
coûte.
[Texte protégé par la SDGL, déposé sur la plateforme numérique Hugo]
[1] Voir
« Des Colts et du Beethoven (Et il paraît que la musique adoucit les
mœurs…)» d’Elsa Errack.
site Elsa Errack
Et merci à Wendy Wendev pour son remarquable travail !
Les lecteurs en parlent:
Avis de Clotide Moreira Da Silva sur Amazon
J’ai été tout de suite attirée par la couverture de ce roman. Le parme romantique, les formes « moderne style » qui entourent cet homme appuyé sur son piano. Il semble concentré. Est-ce le début ou la fin de son récital ?
Cet homme, c’est Louis Moreau Gottschalk, compositeur et pianiste du XIXeme siècle. J’ai plongé avec délice dans cette vie d’artiste, voyageant aux quatre coins du monde, bravant les guerres, les épidémies et les tremblements de terre, toujours accompagné de Firmin, son serviteur et ami. Et puis, il y a les femmes, celles d’une nuit, celles qui l’attendent à la sortie et Ada qui hante sa vie.
La plume est fluide. L’auteur nous entraîne dans des récitals où l’artiste n’a qu’un seul objectif : toucher son public, quel que soit son milieu et sa classe sociale. D’ailleurs, je n’ai pu m’empêcher d’aller écouter les musiques de ce grand Monsieur…et comme pour cette biographie joliment écrite, je n’ai pas été déçue.
Avis du comité de lecture de Librinova
100% des lecteurs recommandent votre livre
Une biographie romancée d’un homme connu dans les
milieux "autorisés " comme il est parfois dit, mais aussi une
biographie très accessible de par l’écriture et les thèmes abordés. L’auteur
nous raconte l’ histoire extraordinaire d’un musicien voyageur et de son homme
de confiance, Firmin. Un tour du monde en un peu plus de 80 jours mais avec
autant de découvertes et d’émerveillement. Tout est fouillé, précis ce qui nous
donne envie de lire sans s’arrêter , emporté que l’on est par le récit et une écriture fluide. Des notes d’auteur en début et fin de livre avec des
biographies, des liens d’œuvres sur YouTube, et une postface revenant sur le
destin des personnages principaux et secondaires. Une lecture dense, érudite
complète et très intéressante.
Résumé
Dans cette biographie romancée de Louis Moreau Gottschalk vous allez découvrir le destin tumultueux de ce compositeur et pianiste américain du XIXe siècle. Né à La Nouvelle Orléans en 1829, il quitte son pays à l’âge de onze ans pour étudier le piano à Paris. Très vite, il y connaît la gloire. Ses compositions originales, inspirées aussi bien de mélodies créoles que de rythmes africains entendus dans sa Louisiane natale, surprennent et enchantent le public européen. Frédéric Chopin lui prédit qu’il sera le « roi des pianistes ». Après une tournée triomphale en Suisse et en Espagne, il revient en Amérique.
Louis
Moreau Gottschalk est un infatigable voyageur, poussé par sa curiosité et son
goût de l’aventure. Toujours accompagné de son fidèle Firmin qui veille tout
autant sur ses malles que sur sa vie, il parcourt inlassablement les Caraïbes,
les Etats-Unis puis l’Amérique du Sud. Malgré une santé fragile, il enchaîne
les tournées, donne concert sur concert et s’épuise dans l’organisation de formidables
festivals qui attirent les foules. Ce virtuose nomade se produit indifféremment
devant les publics éclairés des grandes villes que ceux des campagnes où l’on
n’a jamais vu un piano. Guerres civiles, épidémies de choléra ou de fièvre
jaune, tremblements de terre, accidents de train, révolutions… rien n’arrête
Louis Moreau Gottschalk ! Il est prêt à surmonter tous les obstacles pour
offrir un récital à ses auditeurs ! Reçu par les souverains, célébré comme
le plus grand compositeur de son temps dans nombre de pays, ses admiratrices
sont légion, se disputant un morceau de son gant ou une mèche de ses
cheveux ! Mais lui qui rêve de poser un jour ses bagages et qui court
après la fortune, que trouvera-t-il au bout du chemin ? La belle Ada,
l’actrice rencontrée à New York, sera-t-elle celle avec qui il fondera ce foyer
tant espéré ?
Lisez les premières pages ci-dessous.
Préface
Louis Moreau Gottschalk était à son époque un
musicien mondialement célèbre. Aujourd’hui il n’est plus considéré comme un
compositeur majeur et ses œuvres sont peu connues. Il a laissé environ trois
cents compositions. Sa musique a été jouée jusqu’au début du XXe siècle, puis
peu à peu est tombée dans l’oubli.
Cependant Louis Moreau Gottschalk a eu une grande
influence sur certains compositeurs. Il est notamment considéré comme le
précurseur du ragtime[1]. Certaines de ses
compositions caribéennes comme « Ojos Criollos[2] »,
« Pasquinade », « Souvenir de Porto Rico » et aussi « Le
Banjo », annoncent les premiers accents de ce style pianistique très
syncopé et rapide. Le ragtime mêle au folklore afro-américain des influences
européennes. Il est une des sources du jazz. Scott Joplin, auteur de
« Maple Leaf Rag[3] » (1899), l’une des
plus célèbres compositions de ragtime pour piano, avait entendu les œuvres de
L.M. Gottschalk et s’en est inspiré.
Quelques œuvres de Louis Moreau
Gottschalk à écouter.
·
« Le
Banjo » fantaisie grotesque (1853).
https://www.youtube.com/watch?v=BUpfagdPZJk L’interprétation de Matt
Herskowitz est époustouflante !
·
« Ojos
criollos » danse cubaine (1859).
https://www.youtube.com/watch?v=bnB2crhTtws par Eugène List, pianiste qui a
enregistré de très nombreuses œuvres de L.M. Gottschalk.
·
« La
nuit des Tropiques » symphonie (1858-59).
https://www.youtube.com/watch?v=45bqK_MRHZM
par Richard Rosenberg avec l’orchestre de Caracas, Venezuela.
·
« La
Grande Tarentelle » (1868), pour piano et orchestre. Elle connut
un grand succès longtemps après la mort de L.M. Gottschalk.
https://www.youtube.com/watch?v=N7B9x-Tf45Y
Sources et documents consultés :
-
Le
journal de L.M. Gottschalk écrit en français, retranscrit dans le livre « Les
voyages extraordinaires de L. Moreau Gottschalk, pianiste et aventurier »
de S. Berthier. Editions Favre 1985. Tous les extraits du journal de L.M.
Gottschalk cités dans ce roman proviennent de ce livre.
-
Certaines
lettres du compositeur, à retrouver sur le site www.gottschalk.fr
-
« Louis Moreau Gottschalk » de S. Frederick
Starr. University of Illinois Press,
2000.
-
« Le
pianiste voyageur (la vie trépidante de Louis Moreau Gottschalk) » de
Catherine Sauvat. Payot, 2011.
-
Plusieurs
sites, notamment : www.gottschalk.fr très complet, il propose des
éléments biographiques, des photos et une présentation détaillée de toutes les
œuvres du musicien.
Prélude
Chères
Tropiques
« Hommage
à notre défunt et éternellement regretté Louis Moreau Gottschalk. Le barde des
Tropiques n’est plus ! »
Je
vais essayer d’éloigner les journaux de monsieur. Sinon, il va être désolé
d’apprendre qu’il est mort à nouveau. Il va encore vouloir écrire tout un tas
de lettres pour dire qu’il est bien vivant. La dernière fois on l’avait fait
mourir d’une mauvaise fièvre, aujourd’hui, c’est d’une rupture d’anévrisme. Je
vais me hâter de le retrouver, les médecins sont peut-être revenus auprès de
lui pour lui faire subir leurs tortures. Si je ne les éloignais pas constamment,
ils l’auraient sans doute déjà achevé. On les croirait tout droit sortis d’une
pièce de Molière, avec leurs sangsues, leurs saignées et leurs bains
bouillants. Il faut dire aussi que monsieur ne se ménage pas alors qu’il a une
santé plutôt fragile. Pour préparer ce concert monstre au Tacón, il a tellement
travaillé ! Il n’en dormait plus que deux ou trois heures par nuit. Ce
n’est pas étonnant qu’il soit tombé gravement malade.
-
Monsieur n’est pas raisonnable !
Sortir si vite du lit ! Alors que vous tenez à peine debout.
-
Mon bon Firmin, il faut bien que je m’y
remette, ces concerts de la saison prochaine ne se prépareront pas tout seuls.
-
Monsieur ne peut-il pas en laisser le soin
à son ami, M. Espadero ?
-
Nicolás joue à la perfection mais serait
incapable d’organiser un tel évènement. Pourquoi essaies-tu de cacher ces
journaux ? Ah, je vois, ils annoncent la funeste nouvelle… Donne-les-moi,
de toute façon, tu sais bien que je vais en prendre connaissance.
Moreau[4] jeta un œil sur le
premier.
-
Hum, en voilà une belle oraison funèbre,
je la garderai ; tout comme l’illustration, elle est romantique à souhait.
Je vais encore devoir rassurer tous mes admirateurs, d’Europe ou d’Amérique.
Mais pour lors, je vais me remettre à mon opéra. Apporte-moi un café… et aussi
quelque-chose à manger, j’ai à nouveau un peu faim. Heureusement, car je suis
devenu si maigre que je me suis fait peur en me regardant dans le miroir !
J’ai cru voir un fantôme ou un zombi comme l’on dit par ici !
-
Que monsieur ne parle pas ainsi aussi
légèrement, répliqua aussitôt Firmin en se signant trois fois.
-
Bien, bien, ne fais pas cette tête. Et
tiens, fais-moi préparer un plantain frit.
-
Monsieur ne veut pas quelque-chose de plus
léger plutôt, je sais que vous aimez beaucoup ce plat mais je crois qu’une
petite soupe de pois boucoussou et une décoction de moringa seraient
préférables. Je vous fais apporter ça tout de suite, monsieur.
-
Tu sais bien que je n’aime pas les pois
bou...
Firmin était déjà sorti de la pièce.
Moreau se résigna. Son domestique lui était étonnamment dévoué et s’occupait de
lui comme d’un bibelot chinois mais il n’en faisait souvent qu’à sa tête. Il ne
regrettait pourtant pas de l’avoir engagé, car même s’il n’était pas dénué
d’excentricités, il était doué d’un très solide sens pratique et faisait preuve
d’une extraordinaire ingéniosité. Il l’avait rencontré à la Guadeloupe l’année
précédente. C’était juste après qu’il ait quitté l’île de Saint Thomas pour
échapper à l’épidémie de fièvre jaune qui y sévissait et un séjour étourdissant
à la Martinique. Il y avait connu là un triomphe, lors de son concert donné en
clôture de la fête organisée pour l’inauguration d’une statue de l’impératrice
Joséphine à Fort-de-France. Cela faisait déjà quatre ans qu’il bourlinguait
dans les Antilles, allant d’une île à l’autre au gré de ses envies, volant de
succès en succès. Fêté, applaudi, célébré, chanté partout où il passait,
réclamé par des publics enthousiastes qui l’appréciaient autant pour sa
virtuosité de pianiste et ses compositions brillantes que pour ses qualités
humaines. Il aimait tant ces îles qu’il pensait ne jamais les quitter. Tout lui
plaisait aux Antilles, absolument tout. Les rues pleines de soleil, les
vêtements colorés, la douceur des mœurs, les mélodies créoles, les jolies
filles au regard langoureux, la cuisine, la nature sauvage et splendide, toute
une ambiance qui lui rappelait sa Louisiane natale. Depuis ce printemps 1860,
il s’était à nouveau installé à La Havane, ville qu’il connaissait bien et
appréciait particulièrement. Il y avait retrouvé de nombreux amis et comme
toujours, y avait été accueilli à bras ouverts par la population.
Il se replongea dans l’écriture de l’acte
I de son « Amalia Warden ». Il ne parvenait pas à le finir. Il
buttait sur un dialogue entre la soprano, Amalia, et le roi de Suède, un ténor.
Avec cette interruption aussi… cela fait…
quatre, non, cinq semaines que j’ai été cloué au lit. Et puis maintenant que
j’ai accepté de diriger la troupe du Tacón, je ne vais plus avoir une minute à
moi. Bah, cette compagnie d’opéra… pas ce que j’aurais voulu… il faut dire
aussi avec toutes ces sombres intrigues entre imprésarios. Il y a bien quelques
solistes, les Français et les Italiens surtout, qui sont de bon niveau, mais
les chœurs ! Je crois que jamais je n’arriverai à rien de bon avec de tels
chœurs. Surtout ceux de femmes… qui sont laides avec ça ! Ce n’est
pourtant pas difficile de trouver de belles femmes dans ce pays ! Firmin revint avec la soupe et l’infusion. Une odeur poivrée emplit la pièce. Comme on venait
de frapper à la porte, il alla ouvrir. C’était Nicolás Ruiz Espadero, un vieil ami de Moreau. Firmin
hésita un peu avant de le faire entrer car malgré les injonctions de son
maître, il pensait que cette visite allait le fatiguer.
-
Ce n’est peut-être pas bien raisonnable,
monsieur, vous devriez plutôt vous reposer !
Nicolás, petit homme discret, à la barbe
et à la tenue très soignées, n’osait presque pas entrer. Tout à l’inverse de
Moreau, c’était un casanier solitaire. Il posa son doux regard bienveillant sur
son ami.
-
Je ne veux pas te déranger. Ta santé
s’est-elle rétablie ? Il y a encore deux jours tu étais bien mal. Tu m’as
à peine reconnu.
-
Eh ! Comme tu le vois ! Et me
voilà à nouveau attelé à la tâche. Paludisme, dysenterie et cohortes de médecins
n’ont pas encore eu raison de moi !
-
Tu devrais épargner tes forces. J’ai
vraiment eu peur pour toi. Cette fois, j’ai bien cru…
-
Moi aussi, j’ai bien cru ma dernière heure
arrivée. Mais grâce aux bons soins de Firmin, j’en ai réchappé.
Le regard de Nicolás tomba sur la pile de
journaux.
-
Oh ! Tu as lu… Tu es donc au courant…
Moreau se mit à rire.
-
Ne t’inquiètes donc pas, ce n’est pas la
première fois que les journaux m’enterrent.
-
Non, ce n’était pas pour cela. Mais… donc…
tu n’as pas lu l’article ?
-
Que veux-tu dire ?
-
Eh bien, c’est, enfin… je ne sais pas si…
-
Parle donc, allons ! Inutile de
tourner autour du pot !
Moreau était effondré. Verdi venait de
donner son « Bal masqué », qui avait justement pour thème celui de
son « Amalia Warden ». S’il
ne l’avait pas su à Rome, il aurait cru que Verdi s’était introduit chez lui
afin de l’espionner. En fait ils s’étaient tous deux inspirés du livret
d’Eugène Scribe. Tous ces efforts pour
rien. Toutes ces heures perdues. Il tenta malgré tout de faire bonne figure
devant Nicolás, promettant de créer une autre œuvre dès que possible. D’autant
que le Tacón lui avait alloué un beau budget pour produire ses propres opéras.
Il pensait toutefois que ce ne lui serait pas facile, jamais pour l’instant il n’avait
réussi à dépasser le second acte d’aucun.
Pourtant, il en avait composé des œuvres,
depuis qu’il était dans ses chères Antilles. Même si la multitude de projets
qu’il avait en tête ne s’étaient pas tous concrétisés, il avait énormément
écrit, pour le piano seul surtout, des mazurkas, des polkas, des danses dont
ses « Ojos Criollos » tant plébiscités, puis une symphonie, « La
nuit des Tropiques », et cédant à la mode de l’époque, nombre de transcriptions
d’airs célèbres telle sa « Grande Fantaisie triomphale ». Comme d’habitude il s’était inspiré
d’airs locaux qui l’avaient charmé. Il les avait intégrés à ses compositions en
les réinterprétant à sa façon. Depuis son enfance il avait toujours agi ainsi.
Dès qu’il était impressionné par de nouvelles sonorités, il les mémorisait puis
les reproduisait au piano. Que ce soit un air de « Robert le Diable » entendu à l’opéra où sa mère l’avait
emmené alors qu’il avait trois ans, ou bien les tam-tam des esclaves qui
dansaient au square Congo de La Nouvelle Orléans. Puis venaient des variations,
des improvisations, auxquelles son imagination insufflait des idées neuves afin
de créer une œuvre totalement originale. Depuis qu’il voyageait sa curiosité ne
l’avait pas quitté. Dès qu’il arrivait dans un pays nouveau, il s’imprégnait de
son paysage musical pour en retranscrire les couleurs. Tout l’inspirait. Les
trilles d’un oiseau, la chanson d’un maçon, la berceuse fredonnée par une
lavandière comme la ballade ou le nocturne d’un compositeur célèbre entendu
dans un salon des plus chics. Nourri de toutes ces influences, naissaient sous
ses doigts des compositions atypiques, dont les rythmes nouveaux surprenaient
ses auditeurs.
Par contre, pour pouvoir écrire un opéra
en entier, il lui aurait fallu plus de temps et de calme.
Il reprit sur un ton qu’il voulut
enjoué :
-
Allez, oublions cela. Je vais te montrer
le programme que je prévois pour la saison prochaine.
Moreau commença à se lever, mais comme il
sentit que la tête lui tournait, il demanda à Nicolás de s’emparer des papiers
qui étaient sur la table de son bureau.
-
Voilà. Tu vas sans doute être surpris. J’ai
décidé, comme je te l’avais dit d’ailleurs avant ma maladie, de présenter des
œuvres plus… classiques. J’ai donc choisi « Le jeune Henri » d’Etienne
Méhul, le « Freischütz » de Weber, et « Le Barbier de
Séville » pour la veille de Noël. Oh, il va falloir beaucoup de travail,
car chanteurs et orchestre ne sont pas prêts - surtout ces chœurs de femmes !
- mais j’ai bon espoir.
Nicolás ne répondit rien. Cependant il
paraissait songeur. Moreau devina qu’il avait des critiques à faire.
-
N’hésite pas à me dire ce que tu en
penses. Tu sais que j’apprécie ton avis.
-
Eh bien… tu le sais comme moi… le public
cubain…
-
Allons, ne te fais pas prier, parle
franchement. D’ailleurs, je crois savoir ce que tu vas me dire.
-
Oui, je disais donc… toi qui connais si
bien le public cubain… qui t’adore par ailleurs… lui proposer de telles œuvres…
disons… difficiles, ardues… alors que tu sais bien qu’il préfère des morceaux
plus accessibles, des mélanges, de préférence des airs aux accents locaux,
plutôt que de longs opéras qu’il juge ennuyeux. Rappelle-toi… quand tu étais en
tournée dans les îles avec cette toute jeune soprano, Adelina Patti[5]. Tu n’as pas hésité à te
rendre dans les hameaux les plus reculés et pourtant tu as su t’attirer les
vivats d’audiences les plus frustes en jouant des airs populaires que tous
connaissaient !
-
Bien sûr ! Moreau sourit. On nous
prenait même, Adelina, son père et moi, pour des acrobates ou des magiciens et
l’on s’attendait à ce que l’on sorte des lapins blancs de notre chapeau ou que
l’on virevolte sur un cheval. Or, il est temps désormais d’élever le goût de ce
public. Surtout qu’ici il ne s’agit pas de pauvres paysans de villages perdus
en pleine forêt tropicale mais de la bonne société cubaine. Et pour cela il est
indispensable de lui proposer autre chose. Sinon, jamais il ne sera en mesure
de goûter les sublimes beautés de ces œuvres !
-
Je pense toutefois que tu ferais mieux de
t’adapter à ton audience, comme tu sais si bien le faire. Proposer plutôt tes
propres œuvres, comme « Le Bananier », « La Savane » ou
ton « Caprice espagnol »
qui ont fait ton succès en Europe et sont connues et aimées aussi bien aux
Etats-Unis qu’ici. Enfin, c’est mon point de vue. Tu fais comme tu l’entends.
Soudain Moreau se sentit à nouveau mal. Un
accès de fièvre l’avait repris. Il appela Firmin qui ne put s’empêcher de
gronder son maître. Il se mit à le tutoyer comme il le faisait parfois.
-
Je te l’avais bien dit, c’était trop tôt
pour reprendre tes activités. Tu devrais être au lit.
Nicolás se leva tout de suite pour partir.
Mais avant, il réitéra le conseil qu’il avait donné à son ami deux jours plus
tôt.
-
Firmin a raison (celui-ci hochait la tête
en fronçant les sourcils), tu devrais prendre un vrai repos. Tu devrais
accepter la proposition de José Valdespino qui met à ta disposition la maison
de son habitation sucrière. Au centre de l’île, le climat est plus sain. Tu
seras bien là-bas, la sucrerie n’est pas encore terminée, José ne la mettra en
route que dans quelques mois.
Moreau finit par accepter l’invitation et
dès le lendemain, il quittait le modeste appartement qu’il louait dans un des
vieux quartiers animés de la ville pour gagner la Sierra de Anafe. Après avoir
été secoué pendant sept heures sur de mauvais chemins dans une petite calèche
(dont Firmin avait bien pris garde de relever la capote pour protéger son
maître convalescent de l’ardeur du soleil), il eut le plaisir de découvrir une
magnifique campagne entourée de forêt vierge. C’était un lieu d’une grande
quiétude qui appelait au repos. La maison du maître était basse, elle n’avait
qu’un étage et était bordée d’une large véranda. Tout près poussaient quelques
palmiers et aussi quelques bégonias qui apportaient leurs touches colorées au
paysage. Les trois premières semaines, Moreau se contenta de longues siestes
sur un hamac, d’un peu de lecture et de fumer un cigare de temps à autre,
n’ayant pour compagnie que son domestique et une vieille femme muette qui
s’occupait de la cuisine (et préparait d’excellents plantains frits). Quand il
se sentit mieux, il fit quelques promenades dans la forêt, de bonne heure le
matin, avant que le soleil ne soit trop chaud, sur un petit cheval au pied
suffisamment agile pour éviter lianes entremêlées et troncs moussus renversés.
Il se remit à jouer, le soir, poussant le lourd piano sur la terrasse avec
l’aide de Firmin.
Rapidement une présence féminine lui
manqua. La splendeur de la forêt
vierge, le frais parfum des fougères, le plaisir de cheminer entre les
cléomes et les acajoux, être émerveillé par le plumage multicolore des
oiseaux, être saisi par les notes graves et profondes du campanero, profiter de
ce dolce farniente... Tout cela est certes merveilleux, mais… le serait bien
plus encore si Irène était là, avec moi. Il se demandait encore pourquoi la
belle Irène de los Ríos l’avait quitté sans lui donner aucune explication,
juste avant qu’il ne soit foudroyé par cette crise de paludisme. Etait-elle
partie avec un autre ? Ou alors… Avait-elle appris… au sujet d’Ada ? Il ne le savait pas. Ah Irène, ses beaux yeux noirs, son corps
souple comme une liane. Et sa peau. Ah, sa peau…
-
Vous ne devriez pas fumer autant, monsieur.
C’est votre deuxième cigare ce matin. Certains médecins, comme le Dr Paul
Jolly, assurent que cela aurait un effet néfaste sur la santé.
Moreau mi-agacé, mi-amusé, répondit :
-
Je croyais que tu ne lisais que des
traités dentaires.
-
Oh, pour cela ! Je sais bien que vous
ne voulez pas me croire. Pourtant vous verrez, quand un jour tu me retrouveras
mort avec ma molaire qui aura envahi ma bouche.
Moreau laissa son domestique lui expliquer
pour la énième fois comment, alors qu’il était tout enfant et vivait encore
avec sa mère sur une habitation caféière au Nord de Basse-Terre, un faiseur de
sortilège l’avait envoûté. Depuis, il en était persuadé, une de ses dents ne
cessait de pousser, de pousser, et elle en viendrait à l’étouffer. Il regarda
attentivement Firmin. Il retourna une des feuilles de papier à musique qu’il
tenait en main et entreprit de dessiner son portrait. Un bel homme, ce Firmin. Un grand gaillard, mince, musclé. Il me fait
penser à un autoportrait de Dürer en Christ. Mais un Dürer à la peau métisse et
aux cheveux et à la barbe noirs et frisés. S’il avait pu recevoir une éducation
soignée, il aurait été la coqueluche des salons parisiens. Il aurait connu
autant de succès que le chevalier de Saint-Georges en son temps. Quand on sait
comment il a réussi à apprendre à lire et à écrire le français et également à
jouer du piano et du violon, en cachette du maître de sa mère, une esclave qui
ne parlait que le créole. On ne peut qu’être admiratif. Je trouve d’ailleurs
qu’il se débrouille vraiment bien. Quel dommage. Un destin gâché. Il
n’était pas mécontent de son dessin. Il le montra à Firmin, qui fit un peu la
moue, puis le rangea dans ses papiers.
Après deux mois passés dans ce petit
paradis, Moreau revint à La Havane à la fin de l’été. Malgré l’avis de Nicolás,
il s’entêta à proposer le programme qu’il avait prévu. Ce fut échec sur échec,
notamment la veille de Noël avec ce « Barbier de Séville » qu’il avait eu tant de mal à mettre sur pied. Au bout de vingt
minutes, la plupart des spectateurs avaient quitté la salle, préférant aller
finir la soirée au café du Louvre voisin. Moreau était furieux. Il avait eu
beau se démener, musiciens et orchestre avaient rarement été sur le même tempo.
Des critiques sévères lui firent savoir que, cette fois, il avait vraiment déçu
les attentes de son public.
Quelques jours plus tard, il était invité
au Palais pour une somptueuse fête donnée par le capitaine général Serrano.
Après avoir enchanté l’assistance avec ses « Ojos Criollos » et son « Caprice
espagnol », il aperçut Nicolás dans un coin de la pièce, à demi-caché par
une énorme plante. Dès qu’il parvint à s’extraire du petit groupe d’admirateurs
qui s’était formé autour de lui, il le rejoignit. Il était très étonné de le
voir là, lui qui détestait ce genre de mondanités. Nicolás lui avoua qu’il
n’avait pas pu faire autrement. Il avait déjà refusé trois invitations, il eût
été impoli d’en rejeter une quatrième. Moreau savait qu’il plairait à Nicolás
d’échapper à la foule, il lui proposa de se rendre au jardin. La soirée était
très douce, les fleurs de Mariposas exhalaient de délicates senteurs.
-
Je vais sans doute quitter bientôt mes
chères Tropiques. Tu le sais, quand les affaires ne vont pas comme je
l’entends, j’ai coutume d’aller tenter ma chance ailleurs. Je serais bien allé
au Venezuela, mais avec cette guerre civile... Ou alors au Mexique. Mais là encore
ce n’est pas le moment ! Le pays se bat contre les forces expéditionnaires
espagnoles, britanniques et françaises. Sinon… je rentre en Europe. Reprendre
ma place auprès de Berlioz[6] et de Liszt, comme le dit
ma sœur. Plusieurs me pressent de revenir en France. Comme Pleyel, qui,
parait-il, m’a surnommé le Chopin américain. Mais, il y a aussi, et même surtout,
le problème de mes finances, car, comme tu le sais, il y a ma famille.
Nicolás sourit.
-
Ce n’est guère étonnant ! Quand on te
voit dépenser sans compter. Et puis, tu ne sais pas dire non ! Tu prêtes,
tu donnes, à tous ceux qui te demandent. En tout cas, si tu t’en vas, ta
présence me manquera, nous nous entendons si bien… sur certains points. Nous ne
pourrons plus jouer à quatre mains tes « Ojos criollos ». Et puis… je
n’oublierai jamais ce que je te dois.
Moreau fit un geste de la main pour
signifier que cela n’avait aucune importance.
-
Si, si, sans toi, mes œuvres n’auraient
jamais été publiées à l’étranger. Mais, tu ne m’avais pas dit que…
-
Oui ?
-
Il me semblait que … tu m’as également
parlé… d’une proposition intéressante… aux Etats-Unis.
-
En effet, Max, le frère cadet de Maurice
Strakosch, m’a proposé une tournée. Hum, je ne sais pas si je dois accepter. Il
est vrai que j’ai connu de grands succès dans ma patrie mais j’y ai aussi vécu
de cuisants revers. Tu parlais du peu de goût du public cubain pour les œuvres
classiques ! Dans certaines villes des Etats-Unis, cela est bien
pire encore !
-
Tu pourrais aussi rester ici. Te fixer
enfin. Laisser toute cette activité frénétique et te consacrer à la
composition. Mener une vie simple, tout comme la mienne. Te marier. Tu as bien
été fiancé à un moment, n’est-ce-pas ?
Moreau secoua la tête.
-
Rien de sérieux. Non. Je ne crois pas que
cela me convienne. Pas pour l’instant en tout cas. Et puis, pour faire oublier
cette mauvaise saison au Tacón, ajouta Moreau avec une grimace, j’ai eu l’idée
la nuit dernière de préparer un nouveau concert monstre. Celui que j’ai
donné au printemps dernier a rencontré un tel succès ! Un succès
monstre ! Tous les journaux l’ont plébiscité. Cependant, je le voudrais encore
plus grandiose cette fois-ci.
Nicolás avait l’air perplexe. Trop délicat
pour faire remarquer à Moreau qu’il avait eu raison la dernière fois et que son
ami aurait dû l’écouter, il se permit toutefois d’exprimer ses doutes.
-
Cela va à nouveau te demander un travail
épuisant… Et puis... encore plus grandiose… je ne vois pas comment. La dernière
fois, tu as dirigé plus de six cents musiciens !
-
Plus précisément six cent cinquante
musiciens dont cinquante percussionnistes et quatre-vingts trompettes, en plus
de quatre-vingt-sept choristes ! rectifia Moreau qui adorait citer des
chiffres. Mais ce n’est rien à côté de celui que Berlioz dirigea en août 44 à
Paris.
Son regard devint soudain rêveur comme
s’il assistait à nouveau au formidable spectacle.
-
Te rends-tu compte, mille vingt-deux musiciens !
Deux chefs d’orchestre, cinq maîtres de chant et Berlioz au sommet de tout
cela ! C’était prodigieux !
Nicolás le regardait, un peu inquiet de le
voir si exalté.
-
Hum… Pour ma part, ce n’est pas le genre
de spectacle que je préfère, mais… c’est mon point de vue.
Moreau
se mit à rire.
-
Eh oui ! Je le sais bien, que tu ne
goûtes guère ces éclatants festivals ! Tu aimes ce qui est plus discret. Quant
à moi, je pense qu’un tel évènement me fera retrouver l’entière faveur du
public.
L’affaire devait durer cinq heures et
demie. Quelques courageux seulement endurèrent l’entier supplice, la plupart
ayant fui au bout d’une demi-heure. Le dernier concert monstre que Moreau donna
à Cuba fut une monstruosité sonore. De l’orchestre démesuré qu’il dirigea, dont
quarante pianistes réunis ou plutôt désunis, quatre-vingts trompettes et
tambours - il était même allé embaucher pour l’occasion des musiciens de la
flotte - résulta un tumulte discordant, un désordre bruyant et désagréable.
Je n’ai pas osé le dire à monsieur, car je
ne me permets pas de lui faire des reproches, mais ce concert monstre !
C’est que monsieur aime beaucoup ces grosses machines qui font du bruit. Il en
a pris le goût à Paris, à cause de ce monsieur Berlioz. Il s’est encore une
fois épuisé pour préparer tout cela, passant des heures à réviser des milliers
de pages de copies de partition jusque tard dans la nuit. Je trouve que
monsieur a beaucoup de qualités, mais, il lui arrive de faire de mauvais choix.
De toute façon, comme le dit Voltaire : « Si l’homme était
parfait, il serait Dieu ». Enfin, après cela, monsieur a hésité encore quelques mois, puis… il a
pris sa décision.
[1] « Temps
déchiqueté ».
[2] « Les
yeux créoles ».
[3] « Chiffon
de feuille d’érable ».
[4] Famille
et entourage de L.M. Gottschalk
utilisaient ce seul prénom.
[5] Adelina
Patti (1843-1919) cantatrice italienne, “la Patti” a été l’une des plus grandes
divas de son temps.
[6]
Hector
Berlioz avait été tout particulièrement élogieux, il écrivit, dans « Le
journal des Débats » en avril 1851: « M. Gottschalk est du très petit
nombre de ceux qui possèdent tous les éléments divers de la puissance
souveraine du pianiste […]. Il est musicien accompli. » Les deux hommes entretinrent
une correspondance.



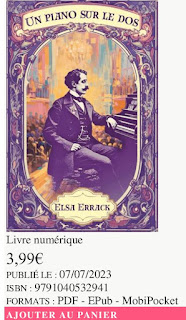


Commentaires
Enregistrer un commentaire